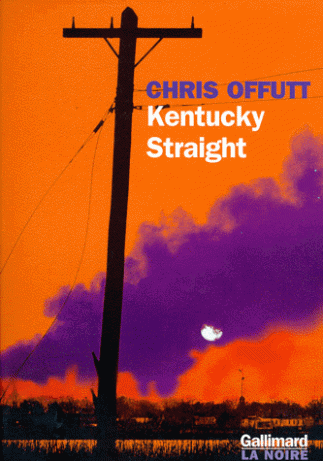This is about honor, about lying, stealing and murdering.
L’histoire commence en 1863, au cœur des tranchées d’une obscure bataille de la guerre de Sécession, cette première guerre dite “moderne”, et qui servira de modèle pour les suivantes: usage des nouvelles technologies industrielles (mitrailleuses, cuirassés et sous-marins, transports des troupes et du matériel par chemin de fer), et mobilisation d’envergure nationale autour d’un conflit total. Sur le terrain, les cartes d’état-major se découpent en petites parcelles, celles à tenir et celles à conquérir; on avance tant que l’on peut dans cette brume boueuse de poudre à canon, jusqu’à déloger l’adversaire et le faire reculer, jusqu’à prendre un petit morceau de colline et s’y terrer, en attendant la contre-attaque: c’est une véritable guerre d’usure, pour les soldats coincés dans cet enfer, comme pour leurs dirigeants qui s’évertuent à repousser quelques frontières mouvantes tracées puis effacées à coups de crayons tendres. “Devil” Anse Hatfield et Randall McCoy, voisins et amis, ont rejoint les rangs confédérés et luttent ensemble contre l’envahisseur du Nord. Lors d’une ultime bataille, alors qu’il parvient par un acte héroïque à sauver sa compagnie, Hatfield décide de déserter une guerre qu’il juge perdue d’avance, et s’en retourne auprès de sa famille. McCoy, témoin de la fuite de son ami, sera bientôt fait prisonnier et croupira quelques temps dans un fort militaire, avant de pouvoir rentrer chez lui, complètement démoli. La guerre est maintenant terminée, les états de l’Union sont à nouveau unis. Mais dans cette petite région des Appalaches où les héros se retrouvent, étroite vallée boisée de la Tug Fork River qui trace les contours de la Virginie-Occidentale à l’est et du Kentucky à l’ouest, la tension monte entre les deux familles. La rancœur de Randall McCoy envers celui qui l’a abandonné laisse bientôt place à la haine, le jour où l’oncle de Anse Hatfield abat le frère de McCoy, au prétexte que ce dernier portait l’uniforme des nordistes pendant la guerre civile. Les membres de chaque clan se réunissent sous l’égide de leur patriarche, et ce qui avait débuté comme une querelle entre deux hommes se transforme peu à peu en véritable conflit, qui embrasera le pays pendant presque 30 ans.
Meurtres et pendaisons sommairement exécutés, raids vengeurs, avocats véreux et chasseurs de primes engagés pour faire le sale boulot, tous les moyens sont bons pour mettre à terre son adversaire. Et finalement ce sont seulement ces moyens, et leurs résultats désastreux, qui alimentent et amplifient le drame d’une simple dispute. De “Devil” Anse Hatfield ou de Randall McCoy, aucun n’est meilleur homme que l’autre, il ne servira à rien pour le spectateur de choisir un parti. La trame scénaristique va d’ailleurs en ce sens de l’égalité des forces et des faiblesses, en proposant une vision égale des deux camps, et rapprochant les différences pour qu’elles aient le même poids, la même portée. Les Hatfield occupent un territoire situé dans les collines de Virginie-Occidentale, et revendent le produit du déboisage de leurs forêts. “Devil” Anse est père d’une famille nombreuse, et les plus grands de ses garçons travaillent déjà pour lui. Il est aussi entouré de ses frères et d’un oncle, qui tous lui reconnaissent la légitimité d’occuper la place de patriarche. De l’autre côté de la rivière qui se trouve au fond de la vallée, nous pénétrons dans le Kentucky, et sur les terres de Randall McCoy. Celui-ci est agriculteur, possède quelques arpents qu’il travaille durement. Il a beaucoup d’enfants lui aussi, plusieurs garçons et filles adultes, ainsi que quelques nièces et cousins qui vivent dans la région. Il est lui aussi le chef incontesté de son clan. Alors que McCoy se rattache à un dieu qu’il invoque constamment pour se venger, Hatfield lui semble se rattacher plus stoïquement à la simple fatalité de la vie. D’une fois que l’on a découvert que les deux faces de la pièce sont les mêmes malgré des peintures différentes, on ne pourra que suivre le récit et la montée en puissance de la violence qu’il contient. Seul un élément vient contrebalancer cette construction: l’histoire d’amour entre Johnse Hatfield et Roseanna McCoy, qui amène, dans toute sa naïveté propre à deux jeunes Roméo et Juliette mâtinés Western, une touche différente de sensibilité, avant que tout ne sombre dans le drame qui occupe la scène entière. On ne cherchera plus à comprendre la genèse de la querelle, qui est pourtant très importante car elle repose énormément sur les séquelles que la guerre de Sécession a laissée sur les communautés du Sud, soit l’impact de la défaite. On avancera dans la série en attendant d’en connaitre le dénouement, tout en sachant qu’il n’y a aucun espoir pour que cela se termine bien; trop de sang versé, trop de haine dans la destinée de ces deux familles, et personne ne peut plus revenir en arrière.
(Les Hatfield de la série History / Les véritables Hatfield, années 1890)
En regard d’un scénario qui se révèle parfois fragile, car trop enclin à nous montrer son ambivalence intrinsèque et finalement peu complexe, c’est surtout dans le soin amené aux décors, aux costumes, à l’ambiance générale, que la série prend pleinement son essor, et exauce toutes ses promesses. S’il a fallut se rendre jusqu’en Transylvanie pour reconstituer cette partie des Appalaches, question budget j’imagine, on s’y croirait vraiment, les paysages sont de toute beauté, et les saisons défilent à la manières de superbes peintures. Chaque plan est comme une photographie d’époque explosée de couleurs et de teintes. Il en va de même pour les personnages, aux vêtements refaits d’après les photos d’époque. Les tissus lourds et les velours grossièrement côtelés, la démarche pesante qui les accompagne, les vestes en peau brute et les vieux chapeaux défoncés. Les bottes sales, les ongles noirs, barbes jaunes de glaviots et fusils rutilants; tout y est absolument, vous regardez ça et vous y êtes. La qualité du casting est aussi à saluer: Kevin Costner, connu pour ne jamais en faire trop avec les expressions, y trouve un personnage en or avec cette composition de patriarche bourru; Paxton est magnifique jusque dans l’expression de la vieillesse courbaturée; et puis chaque second rôle sonne parfaitement juste, le dosage est parfait, c’est comme si les vieux clichés parlaient et se mouvaient devant nous. Ces vieux clichés, ce sont justement ce que nous retrouvons par après sur le net, de ceux qui nous disent que Hatfields & McCoys est tiré d’une histoire vraie; que ces types, au-delà d’une histoire fictionnelle et simplifiée pour en faire 3 épisodes de 90 minutes, ont vraiment existé, et se sont vraiment battus sur leurs maigres terres. L’histoire semble être connue aux États-Unis, et faire partie du folklore; on peut trouver des restaurants, des parcs d’attractions qui portent leurs noms, on les a même vus dans des cartoons, symboles de ces premiers Hillbillies, paysans des montagnes regroupés en fratries qui passent leur temps à se battre avec leurs voisins. En tout cas pour ma part j’ai fait une très belle découverte avec cette série. Et ce qui m’a plu particulièrement, c’est ce petit fantasme que j’ai et qui s’est réalisé ici, c’est que j’ai pu voir des vieilles photographies s’animer, que j’ai pu entrer dans le cadre et voir ce qui s’y trouvait derrière, ce qui s’y trouvait caché. Essayez avec cette série, vous ne regrettez certainement pas le voyage. C’est infiniment beau, et brut à la fois, une vraie petite splendeur comme on les aime.
“Hatfields & McCoys” (2012)
minisérie 3 x 90 min. / History Channel
En DVD