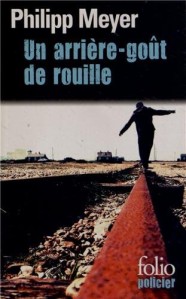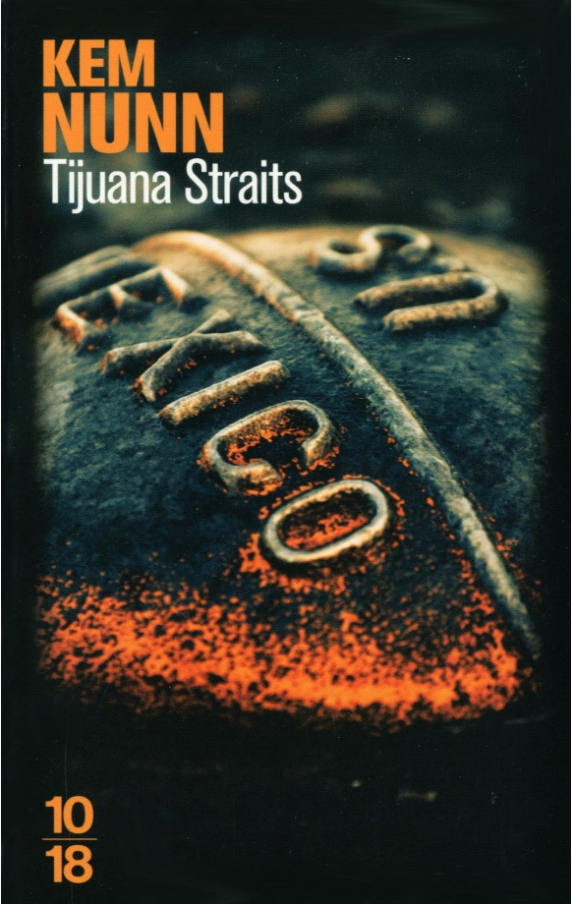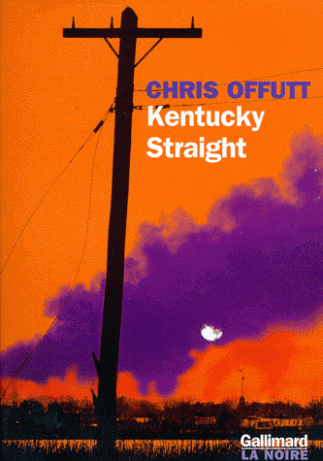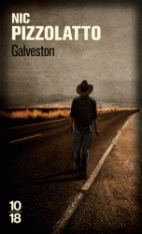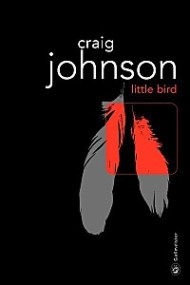Requiem for an American Dream
“La population de la vallée avait recommencé à augmenter mais les revenus baissaient toujours, les budgets diminuaient et les infrastructures n’avaient fait l’objet d’aucun investissement depuis des lustres. Ils avaient les moyens d’une petite ville mais les problèmes d’une grande. Comme disait Ho, on approchait du point de non-retour. Sauf peut-être Charleroi et Mon City, presque toutes les autres villes de la vallée l’avaient franchi et c’en était fini. La semaine précédente, un type s’était fait descendre en plein jour à Monessen. C’était partout pareil; et les jeunes, la façon dont la plupart se résignaient à l’absence d’avenir, c’était comme de regarder s’éteindre des étincelles dans la nuit.”
En la petite ville de Buell, Pennsylvanie, en ces premières années du XXIe siècle: les usines d’acier, qui faisaient la fierté de la région, fleurons de l’industrie d’un pays alors en perpétuelle construction, et d’où sont sortis les matériaux qui ont permis l’avancée des lignes de chemin de fer, la réalisation du Golden Gate Bridge, du Hoover Dam, de l’Empire State Building et de tant d’autres monuments emblématiques de la civilisation américaine, ont maintenant toutes fermé leurs portes. Faillites, délocalisations; à l’image de tous ces bâtiments laissés à l’abandon, c’est la contrée entière qui semble agoniser lentement, et ceux qui n’ont pas fui la zone sinistrée survivent grâce à quelques allocations et à la débrouillardise des plans sans lendemain. Isaac English et Billy Poe, deux de ces gamins de Buell, fils de prolétaires qui souhaitaient leur offrir un avenir meilleur, qui auraient pu partir comme d’autres de leurs camarades trouver un job au Michigan ou étudier dans de lointaines universités, ont pourtant choisi de rester; le premier pour s’occuper de son père malade, et le second car il craignait simplement d’échouer. À 20 ans, privés d’avenir, ils décident pourtant de s’enfuir, et Isaac dérobe toutes les économies de la famille, soit quelques 4’000 dollars, avec pour projet de rejoindre la Californie par les petits sentiers. Au terme du premier jour de leur escapade, ils choisissent de camper dans les ruines d’une aciérie. Mal leur en prend, car ils se retrouvent sur le territoire d’un groupe de vagabonds, hobos hostiles qui s’attaquent bientôt à eux. Dans la rixe qui s’ensuit, Isaac balance un outil métallique à la tête de l’un de ses assaillants, et le tue sur le coup. Pris de panique, les deux amis se sauvent et rentrent chez leurs parents. Le lendemain du drame, ils apprennent que la police est déjà sur le coup, et qu’un faisceau d’évidences, d’objets oubliés sur place, les désignent comme suspects…
Isaac, convaincu d’être rapidement identifié, embarque dans le premier train venu, muni de son précieux petit pactole: direction le grand nulle part, et le plus loin possible. Billy ne se résout pas à quitter Buell, et tente de jouer profil bas, feignant d’ignorer qu’il pourrait lui-même être accusé de meurtre. Mais l’étau se resserre rapidement, et la justice aux prises avec une incontrôlable montée de l’insécurité et de la violence dans le comté voudra faire de ce fait divers un exemple. Même le shérif Harris, ami de la famille et amant de longue date de sa mère, ne pourra empêcher l’inculpation, puis l’emprisonnement. Livré à lui-même, jeté dans l’une des pires prisons que l’on puisse imaginer, se sentira-t-il encore incapable de trahir, et de dénoncer son ami, qui l’a pourtant abandonné? Lorsque l’on a perdu plus que le peu de choses que l’on avait, que reste-t-il à mettre en jeu, sinon son propre honneur?
Ruines de la Bethlehem Steel Company, Pennsylvanie (photo rhruins.blogspot)
Un arrière-goût de rouille commence comme un excellent roman noir classique, ambiance rurale crépusculaire, envers du rêve, proche du premier livre de Ron Rash ou des nouvelles de Chris Offutt – et si d’ailleurs vous n’avez pas tant apprécié le Goat Moutain de David Vann, qui aborde lui aussi la thématique du crime commis par instinct, celui-ci devrait vous convaincre plus facilement. Les chapitres sont découpés en cadrant sur les différents protagonistes de l’histoire: Isaac et Billy bien sûr; mais aussi le shérif Harris, homme ambigu à la morale évoluant selon sa notion personnelle de la justice; Grace, la mère de Billy, femme mal-aimée qui se sent littéralement moisir dans son mobile-home décati; et puis encore Lee, la sœur d’Isaac, qui elle a quitté bien tôt le foyer pour s’en aller réussir sa vie à New York, réussite dont seules les apparences entretenues permettent de témoigner. Mais au-delà du pur polar choral enchainant les récits, genre qui compose la charnière de l’ouvrage et dont la forme impose le rythme, c’est tout le décor présenté, dans toute sa terrible logique, en un sens historique, qui déborde du cadre, dynamite la simple narration et l’explose complètement. Philipp Meyer aborde ici l’idée de la fin d’un certain rêve américain, tel que l’on vécu ceux qui y ont participé ou qui en descendent, ceux qui ont rejoint les usines et qui ont cru pour eux et leurs enfants au rêve de prospérité du made in america, avant que tout ne soit perdu, dilapidé par les conseils d’administration, les politiques, les investisseurs, ou la fatalité. Le paysage dans lequel évoluent les personnages aux espoirs envolés d’Un arrière-goût de rouille est une ruine immense à ciel ouvert: bâtiments effondrés et rongés, gangrenés, et où paradoxalement la nature reprend ses droits, dans la plus parfaite et luxuriante anarchie; villes vidées de leurs habitants, démembrées et défigurées, ghost-towns à venir rappelant les images d’anciennes ruées, avortées, figées à l’agonie dans le temps nostalgique d’un éternel et formidable passé, âge d’or fantasmé, s’il a un jour existé.
Une autre Buell: ville de Braddock, Pennsylvanie (photo lowsunofwinter / panoramio.com)
C’est Le Fils, prodigieux second roman de Philipp Meyer, qui m’a fait découvrir cet ouvrage. Dans un entretien qu’il a donné cet été, il a expliqué qu’après avoir évoqué la fin du rêve américain pour la classe ouvrière, il a cherché à creuser les origines de ce mythe. Je suis donc allé dans l’autre sens, et après avoir été époustouflé par la fresque somptueuse du Fils, qui couvre deux cents ans d’Histoire des États-Unis, je me suis embarqué les yeux fermés dans Un arrière-goût de rouille, petit chef-d’œuvre caché, tellement riche et à la mécanique secrète si bien huilée. Une grande part du génie de cet auteur se trouve déjà dans cette première publication: le souci de la véracité historique, la générosité dans l’écriture romanesque, qui trouve autant de souffle dans les parties introspectives que dans ce qui peut être considéré comme de l’action pure (et souvent dure), l’art de “photographier” un paysage et de le rendre vivant, organique et parfois dévorant, en quelques phrases seulement. Il faut aussi parler de la finesse déployée dans la création des ses personnages, tous très complexes, attachants, vivants, et notamment dans la création de puissants caractères féminins. Meyer possède un art de conteur inédit, autant qu’il est capable de proposer comme des synthèses des littératures de ses contemporains, dont on peut retrouver des échos au fil des pages. J’ai tout à apprendre et je ne suis qu’un modeste explorateur ici dedans, mais j’ai l’impression que je serais passé à côté de quelque chose si je n’avais pas lu ses deux romans. Philipp Meyer figure dorénavant au panthéon de mes écrivains favoris (à court d’arguments, je l’ai même traité de “dieu” une fois devant une amie, mais j’ignore si elle m’a cru); en tout cas je n’aurai de cesse de clamer haut et fort que ses bouquins sont absolument géniaux. Et vivement le troisième, nom d’un petit cheval!
Un arrière-goût de rouille ( American Rust – 2009)
Philipp Meyer / Editions Denoël, 2010; Editions Folio Policier poche, 2012
traduit par Sarah Gurcel
13 times, de 2nd St. Rag Stompers (2012):
When I travel this wild world alone…