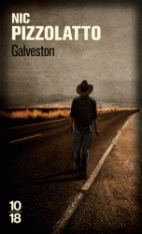Remember the Alamo
“On n’a pas le choix, nous autres: on doit rester en mouvement pour pas qu’on nous mette une chaîne à la jambe. Et ça, c’est valable partout. Quand cette révolution sera terminée, le Texas sera comme n’importe quel État des États-Unis. Il y aura une loi pour tout et une paire de menottes pour aller avec.”
Louisiane, milieu des années 1830. Son Holland, gamin descendu de ses lointaines montagnes du Cumberland, Tennessee, en quête de sa bonne fortune, n’aura décidément pas eu l’occasion de goûter aux charmes de la Big Easy: sitôt arrivé à La Nouvelle-Orléans, “ce reste d’Europe où des hommes qui ne parlaient même pas l’anglais s’en mettaient plein les poches en spéculant sur le coton”, il est arrêté par des officiers de police français et, pour un vol qu’il n’a pas commis, condamné à 10 ans d’emprisonnement dans un camp pénitentiaire perdu au fin fond d’un bayou, tenu d’une main de fer par les frères Emile et Alcide Landry. Ne rêvant que de s’échapper, il se lie bientôt d’amitié avec un autre détenu, Hugh Allison, ancien brigand, briscard, aventurier coincé à vie dans cet enfer; ce dernier prend Son sous son aile, et lui promet qu’ils s’enfuiront dès qu’une occasion se présentera. Un jour, alors qu’ils triment au labeur sous la seule surveillance de l’un des frères Landry, ils blessent gravement leur gardien par mégarde. Décidant que cet accident sera leur seule chance de reprendre leur liberté, ils achèvent la besogne en tuant Alcide, puis volent son cheval et prennent la fuite, direction plein ouest. Là-bas, au-delà de la Sabine River, s’étend le pays du Texas, terre revendiquée par le Mexique, où les américains et ceux des États de l’Union ne devraient plus pouvoir les rattraper.
La Sabine River, frontière entre la Louisiane et le Texas (photo toledo-bend)
Une fois la frontière traversée, Son et Hugh rencontrent une petite tribu d’Indiens Choctaws, qui va les héberger pour quelques temps. Ceux-ci, des nomades commerçants, qui auront vite fait de leur échanger une squaw contre quelques objets, leur apprennent que la région traverse une période de grands troubles; les voyageurs avec qui ils marchandent ne sont plus que des soldats, mexicains ou texians, des anglos venus agrandir les rangs de l’une ou l’autre armée, alors qu’une guerre semble se préparer. Les fermiers américains venus coloniser le Texas avaient toujours été plus ou moins tolérés par l’autorité du Mexique, qui y trouvait son compte au vu du nécessaire besoin de peupler les terres, de “civiliser” le territoire contre les hordes sauvages de Comanches et d’Apaches. Mais aujourd’hui, les étrangers se sont regroupés, et manifestent clairement leur volonté de s’emparer du Texas, pour en faire une république indépendante. Sous les ordres du général Sam Houston, de Jim Bowie ou de Davy Crockett, les miliciens en armes n’attendent qu’un seul prétexte pour se lancer dans le combat. Alors que les deux échappés découvrent que leur tête à été mise à prix, et que des chasseurs de primes sont à leur trousses, ils n’ont bientôt plus d’autre choix que de tenter de rejoindre l’un ou l’autre de ces bataillons. S’ils parviennent à retrouver la trace de Jim Bowie, que Hugh a bien connu dans sa tumultueuse jeunesse, ils seront peut-être finalement protégés par les événements qui se profilent. On dit que Bowie et ses hommes se sont emparés de la ville de Bexar (l’ancienne San Antonio), et qu’ils ont fait de la petite mission d’Alamo une forteresse improvisée. Dernière lueur dans la nuit de leur fuite éperdue, c’est donc là-bas, à Fort Alamo, que Son et Hugh, maintenant accompagnés de Sana l’Indienne taciturne, iront peut-être trouver leur salut.
Fort Alamo, autour de 1850 (photographe inconnu)
Texas Forever, dont le titre français rappelle l’exclamation que prononçait Sam Houston lorsqu’il engageait des hommes dans son armée, est d’abord un excellent western, au rythme soutenu et aux personnages hauts en couleur, reposant principalement sur l’opposition complémentaire entre les deux principaux caractères que sont Son Holland, sorte de kid droit et parfois très maladroit, et Hugh Allison, le vieux loup rusé qui a déjà tout vu, potache, foireur mais bon compagnon. Leur cavalcade impose donc l’avancée rapide de l’intrigue, respectant l’esprit du roman d’aventures, et suffit à elle seule à susciter une grande part de l’intérêt de lecture. En un mot, c’est un bouquin qui se dévore. Ajouté à cela, c’est tout le contexte historique, soit la mise en valeur d’un événement aussi important et fascinant de l’Histoire américaine, qui rend l’expérience vraiment jouissive. La guerre d’indépendance du Texas, et surtout Fort Alamo, c’est l’un des mythes qui a nourri les fondations d’une nation, c’est le drame, devenu légende, qui s’inscrit dans les gènes et qui fait dire “Souvenez-vous d’Alamo”, en guise de représailles, pour la victoire définitive, ou en mémoire des combattants perdus érigés en héros, autant qu’il rappelle, sentimentalement, nos bons souvenirs de spectateurs ou de lecteurs amoureux de la culture populaire. Symbole, mémorial, et récit. J’ai lu quelque part – il faudrait que je retrouve – que les États-Unis avaient été capables de créer leur propre mythologie, au regard pourtant de si peu de temps dans l’Histoire: pays aux sangs neufs, nourri de tant de cultures autant que débarrassé des images des lointains passés. Nouveaux mythes de la Frontière, mythes de la Conquête, figures héroïques ou damnées sur lesquelles une nouvelle Histoire est née, passée dans l’inconscient collectif, grâce aux récits et aux symboles justement. Et l’image de cette petite forteresse, résistant vaillamment aux assauts, face aux lugubres sons des trompettes ennemies, en fait incontestablement partie. Texas Forever, sorte de one-shot dans la bibliographie de James Lee Burke, qui se consacre plutôt aux policiers contemporains avec sa série des Dave Robicheaux, est une de ces merveilleuses petites pépites, sorties de nulle part, à découvrir de toute urgence car c’est un vrai plaisir.
James Lee Burke (crédits photos inconnus de moi)
Texas Forever ( Two for Texas -1989)
James Lee Burke / Editions Rivages, 2013; Editions Rivages poche, 2014
traduit par Olivier Deparis
The Goddam Gallows: 7 Devils (2011)