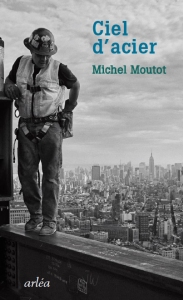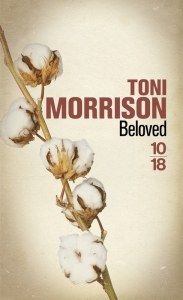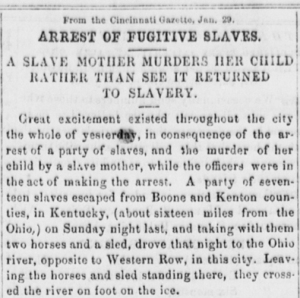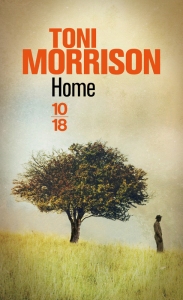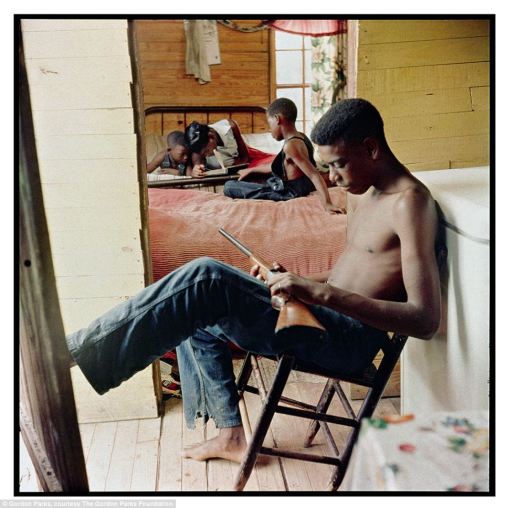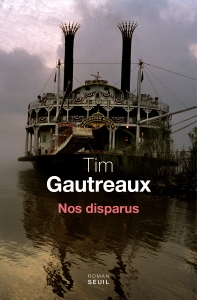House of Cards
“Nous voulons simplement explorer une période de notre histoire où se côtoyaient la paranoïa, la schizophrénie, la misogynie, le racisme et l’antisémitisme à l’ombre de notre pudibonderie fondatrice. C’était le temps comme l’écrivait William Styron de la “passerelle chancelante entre le puritanisme de nos ancêtres et l’avènement de la pornographie de masse”. On y parlera aussi du pouvoir, même si c’est un sujet un peu démodé.”
Mémoires apocryphes de Clyde Tolson, fidèle second de J. Edgar Hoover pendant toute la durée de son mandat de Directeur du FBI, soit près de 48 ans à la tête d’une agence fédérale de police judiciaire et de renseignement. À travers le regard de son ami, seul confident et peut-être amant, se dresse le portrait d’un homme qui, traversant les tempêtes et naufrages d’un siècle mouvementé, aura bien vite compris que la véritable mainmise sur le pouvoir ne s’obtient pas avec un programme électoral échelonné sur 4 ou 8 ans, ni sur des paroles ou des promesses, mais sur l’enracinement profond de sa propre influence sur tout ce qui est décidé. Gardien de la morale et des valeurs puritaines, ayant servi sous les ères de 8 présidents, Hoover aura préféré utiliser son immense force de frappe pour lutter contre ce qu’il nommait le “cancer” communiste, la menace rouge. Ses différentes actions, depuis la Seconde Guerre mondiale et pendant les grandes crises de l’époque de la Guerre froide, auront profondément – et durablement – participé à modifier les règles de la politique américaine. Niant pendant longtemps l’existence d’une organisation mafieuse ramifiée dans tout le pays, au risque de se mouiller lui-même, il n’aura pourtant pas manqué de recueillir, grâce à un réseau d’espionnage complexe mis en place par son service, quantité d’informations compromettantes qui pouvaient lui servir à faire chanter, ou tomber, quiconque se mettait en travers de son chemin.
J. Edgar Hoover et Clyde Tolson, octobre 1942
Ce qui se dresse bientôt face à lui, et qu’il n’avait pas prévu, c’est l’éclosion d’une véritable nouvelle dynastie, celle des Kennedy. Premières rencontres dans les années 1930 avec le père, Joe, investisseur roublard qui deviendra ambassadeur au Royaume-Uni alors que les premières bombes pleuvent sur Londres. De retour au pays, ce dernier s’engagera dans une politique isolationniste, quitte à tremper sa verve dans la boue antisémite de l’époque. Vision, telle celle de Charles Lindbergh peut-être, que l’Amérique a plus en commun avec les dictatures fascistes qu’avec le reste de l’Europe ? Il n’en reste que cette posture, contredite par l’Histoire, l’empêchera à jamais de briguer sa place à la Maison-Blanche. Au sortir de la guerre, il mettra donc sa fortune en jeu pour que l’un de ses fils y parvienne. L’ainé, engagé sur le front, est mort au combat; l’héritier sera donc le second de ses garçons, John Fitzgerald, qui rejoint le parti démocrate, avant de se faire élire, quelques années plus tard, sénateur au Congrès. À ce moment de l’histoire, Hoover a déjà récolté ses infos, et sait qu’il devra compter avec ce jeune loup ambitieux. Mais ce qu’il ne comprend peut-être pas, c’est que cet homme, et ceux de sa génération, n’ont plus rien à voir avec les anciens de son époque. Ces nouveaux venus, cette “brightest generation” des jeunes héros de guerre, parlent de Nouvelle Frontière, d’un monde nouveau à venir, autant technologique que plus égalitaire. Et surtout, cachant quelques travers honteux, ils savent soigner leur image publique, utilisant les médias mieux que Hoover, pour le Bureau ou pour lui-même, n’ai su le faire. Ils semblent vouloir jouer leurs cartes sans tenir compte de lui, du FBI et de sa stratégie, ce qui lui est insupportable. Pourtant, malgré ses efforts, Hoover ne parviendra pas à empêcher l’élection de Kennedy à la présidence, le 8 novembre 1960. Début des 1000 jours de règne.
JFK, Robert Kennedy et J. Edgar Hoover, 1961
L’une des premières actions menées par le président est de virer l’Attorney General (équivalent d’un ministre de la Justice) pour le remplacer par son jeune frère, Robert Kennedy, qui devient ainsi le supérieur de Hoover. Bobby, décrit comme un petit roquet enragé, ne se prive pas de couper l’herbe sous les pieds du Directeur, allant jusqu’à ordonner de limiter le pouvoir d’action du FBI à l’intérieur des frontières. Critiquant ouvertement le service, il tente aussi de le réorienter vers la lutte contre la pègre, vers ce dangereux cul-de-sac dont personne ne sortira indemne. La rumeur persistante court aussi que, si JFK est réélu pour un second mandat, il exigera la démission du vieux Edgar. Désastre de la Baie des Cochons, Crise des missiles cubains, puis tentative de Détente de l’Amérique face au bloc communiste: alors que le monde, pris au piège, était à quelques secondes de sombrer, il s’est trouvé des gens pour juger ce président trop mou, peut-être un peu trop rouge. Il a commencé à se murmurer, dans des cercles restreints que l’on croyait confinés, qu’il faut au plus vite l’éjecter, qu’il faut s’en débarrasser. Ce ne sont pas la mafia, ni les politiciens, ni les cubains, ni les hommes d’affaires texans: c’est une idée. Et Edgar sait, lui qui entend tout, qui a des oreilles partout, il sait. Il sait et il ne fait rien.
Dallas, 22 novembre 1963 (film Zapruder)
Apogée de l’intrigue du roman, l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy marque l’instant où le jeu politique engagé par les différents acteurs se transforme en une arène sauvage, et à la vue de tous, utilisant les mêmes codes médiatiques qui ont fait et défait les prétentions de chacun. Ce n’est pourtant pas la fin de l’histoire: quelques années plus tard, des personnages comme Martin Luther King et Robert Kennedy tomberont aussi sous les balles de tueurs solitaires, sans que les différents services fédéraux, dont le FBI, ne puissent empêcher les meurtres. À la tête du Bureau, toujours Hoover, en place jusqu’à sa mort en 1972. La malédiction d’Edgar, c’est peut-être d’avoir incarné presque à lui seul cette zone d’ombre de la justice et de la politique américaines, de 1924 jusqu’à son décès. D’avoir tout su de tout le monde, d’avoir joué avec tout le monde pour asseoir durablement son siège auprès des plus hautes sphères décisionnelles, quitte à ruiner la vie de ceux qu’il jugeait comme ses adversaires, et quitte à ruiner la sienne en ne la vivant pas.
La malédiction d’Edgar est une fiction fascinante, énormément documentée, et qui fait voyager le lecteur, en finalement peu de pages, le long de presque tout un siècle. J’ai néanmoins pris quelques distances avec les personnages, car je les ai trouvé présentés d’une façon délibérément très noire, trop noire même; JFK y est plutôt décrit comme un arriviste sans scrupules, alors que tout ce que j’ai pu lire ces derniers temps, et l’image que la mémoire universelle rend de lui, lui prête plutôt un vibrant hommage. Concernant son assassinat, l’auteur penche donc vers la théorie du complot, question dont on n’aura pas de réponse ( si on aura une un jour) avant que tous les contemporains du “crime du siècle” ne soient morts. En tout cas, la littérature autour de cet événement est d’une richesse incroyable, et comme il y a presque autant de pistes que d’enquêteurs, les angles d’attaque ne manquent pas. C’est parfois très tordu, surtout depuis internet, et c’est parfois comme une excellente Série noire. Dans ce roman, on pense parfois aux polars de James Ellroy pour l’ambiance, et à la série House of Cards pour la sophistication des manigances diverses. Et c’est donc un sacré bon show que ce bouquin, comme (presque) seuls les américains peuvent en proposer… À découvrir ou redécouvrir!
La malédiction d’Edgar
Marc Dugain / Editions Gallimard, 2005; Editions Folio poche, 2006
“A Hard Rain’s A Gonna Fall“, de Bob Dylan (1963), the voice of his time:
“Qu’as-tu entendu, mon fils aux yeux bleus?
Qu’as-tu entendu, mon cher et tendre?
J’ai entendu le son du tonnerre, rugir un avertissement,
Entendu le hurlement d’une vague qui pourrait noyer le monde entier…
Et c’est une dure, c’est une dure, c’est une dure, c’est une dure,
C’est une pluie dure qui va tomber.”