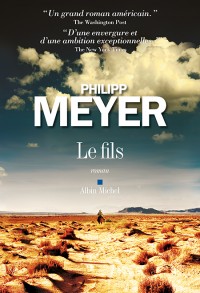Lost in La Prairie
“Le soir, après avoir retouché les paysages vierges peints pendant la journée, Catlin annonce, dans ses lettres, la mort du vert. Quand Baudelaire le découvrira, le vert commencera d’être clôturé. Avec des fermes, avec des cow-boys armés, des éleveurs de bétail, avec des guerres, de nouvelles lois, de nouvelles frontières! La fuite, l’errance, la variole, l’alcool, les réserves enfin ou la prison. La fin de la vie.
Catlin sait et il peint. Il accumule les preuves de la grande vie des Sioux.”
Presque 30 ans après la fameuse expédition des capitaines Lewis et Clark qui, de 1804 à 1806, auront traversé le continent nord-américain afin de trouver un accès vers l’océan Pacifique, l’immense territoire à l’ouest des fleuves Mississippi et Missouri demeure en grande partie méconnu. Au-delà de la ville de Saint-Louis, cité-frontière au confluent des eaux, c’est le presque grand vide qui s’étend: c’est la terre de tous les prodiges possibles, autant que de tous les dangers. La carte et la littérature établies par les prédécesseurs seront encore à affiner, à compléter par les récits des quelques trappeurs, chasseurs, explorateurs qui s’y aventurent. Les descriptions scientifiques de ce Nouveau Monde, emplies de l’esprit encyclopédique des Lumières, cet esprit cher à la vision qu’a eue le président Jefferson lorsqu’il a donné le cahier des charges à l’entreprise de Lewis et Clark, se trouvent bientôt enrichies d’une nouvelle énigme à aborder: qui sont ces natifs que l’on rencontre, ces membres de plusieurs dizaines de tribus éparpillées dans la nature, et qui semblent pourtant participer d’un même système, ou en tout cas d’une vaste organisation ramifiée sur des milliers de kilomètres carrés. Qui sont ceux que l’on nomme les Indiens des Plaines? Quelques journaux, carnets de voyages et correspondances en esquissent le portrait; restait aussi à les dépeindre.
Il s’est trouvé qu’un peintre, portraitiste de la haute société pennsylvanienne, en a eu sa claque de bichonner des croûtes pour les lords et les entrepreneurs. “Go West, Young Man“, c’est ce qu’a peut-être entendu George Catlin avant beaucoup d’autres, le poussant à entrer en contact avec ce vétéran de William Clark, devenu entre-temps le principal chargé aux affaires indiennes pour le gouvernement, afin qu’il lui fasse passer l’invisible frontière. Entre 1830 et 1836, Catlin a pu rendre visite à plus de 50 tribus indiennes, recueillant ainsi une masse de dessins, de peintures, de notes d’observations, voire d’objets échangés, le tout d’une valeur inestimable. S’il fut l’un des premiers artistes-ethnologues à renseigner le monde sur la prodigieuse découverte du lointain Ouest américain, allant jusqu’à rendre visite à plusieurs têtes couronnées de la vieille Europe, ou présentant ses œuvres dans les salons d’art parisiens que fréquentaient Gautier, Sand ou Baudelaire, il fut l’un des premiers aussi à se rendre compte de sa fragilité face à l’avancée de cette étrange Destinée manifeste revendiquée par l’autre civilisation. Instant charnière de l’Histoire, début du compte à rebours avant l’explosion du grand drame, Bison de Patrick Grainville évoque le séjour de Catlin, en 1832, auprès d’une tribu de Sioux Lakotas, dans la contrée vierge et sauvage que l’on nommera quelques années plus tard l’État du Dakota du Sud.
(photo: South Dakota Department of Tourism)
Il faudra poursuive la piste loin après Fort Pierre pour découvrir les avant-postes du campement sioux; et quelle surprise pour leurs habitants de voir arriver cet étonnant attelage, composé de Catlin et de son interprète Bogard, équipés de rouleaux de toiles et de ferrailles pleines de gouaches. Peindre les chefs, et peindre la vie du village, voila le but que s’est fixé l’homme Blanc doté d’une puissante médecine. Face au leader Aigle Rouge, face aux nobles guerriers Élan Noir et Tonnerre Riant, face aux femmes et aux enfants, puis avec eux, tout au long de leurs pérégrinations au fil des saisons, de leurs errances à travers la prairie, à la poursuite de l’immense mer brune et ocre de bisons. Le puissant animal, le tatanka vénéré, c’est le sel de la terre, c’est la vie. La plupart des activités de la tribu se sont ainsi harmonisées avec le lent mouvement migratoire des troupeaux, et presque toutes leurs ressources en émanent: nourritures, vêtements, artefacts faits d’os, de cuir ou de cornes, feux de bouses, colle de sabots, etc. Rituels de chasse, danses, fêtes et cérémonies d’exorcismes divers rythment les parcours des hommes au regard du soleil et de la lune. Jeux où l’adresse et la bravoure, dans la poursuite du gibier comme dans la guerre intestine livrée aux ennemis héréditaires, façonnent les corps et les âmes, attisent la frénésie de vivre. Et Catlin lui-même, observateur qui se veut impartial, pourtant confident et allié, et bientôt sous le charme de la jeune squaw au nom magnifique de Cuisses, se sentira comme un membre à part entière de la nation Sioux. Le personnage bien que haut en couleur vêtu d’une redingote parmi les pagnes et fourrures s’efface bientôt progressivement de la narration: les véritables héros de ce roman ce sont ces amérindiens qu’il décrit. Et parmi eux, deux caractères portent l’intrigue presque à eux seuls: Louve, une Indienne Crow captive de la tribu, et Oiseau Deux Couleurs, le chamane berdache, soit l’homme-double, le travesti sacré, ayant adopté des mœurs particulières et développé une apparence féminine.
George Catlin: Buffalo Hunt (1832)
George Catlin: Shón-ka, The Dog, Chef Sioux Lakota (1832)
Pour plus de reproductions des œuvres de Catlin, voir ici
Bison est un roman épique au souffle puissant, empli de l’esprit des grands espaces; comme j’ai pris cette petite habitude de reporter mes lectures sur mes cartes et atlas, afin de poursuivre le voyage d’une façon différente, j’avoue que je me suis souvent égaré, perdu dans l’immense prairie, ou longeant des rivières inconnues. Peut-être était-ce une volonté de l’auteur qui cherchait à brouiller les pistes, afin de rendre à cette histoire son aura de magie, magie d’avant l’aplanissement total de la géographie, rendue symétrique et abstraite. Tant mieux en tout cas, c’était un formidable prétexte à l’évasion. De plus, l’exploration d’un monde d’avant la Conquête de l’Ouest, en ces quelques années où il semblait possible que deux univers se rencontrent et partagent, fascine autant qu’elle laisse un goût amer. Il aurait fallu plus de George Catlin, il aurait fallu d’autres expéditions comme celle de Lewis et Clark, ou des Edward Curtis d’avant la fin des temps. Mais même cela, est-ce que ça aurait changé quelque chose à l’Histoire? Enfin, avec ce personnage inédit de peintre “into the wild”, Patrick Grainville nous offre de superbes pages où la nature, mise en images et transfigurée par les mots, devient matière vivante, envoûtante, exaltant tous les sens. À découvrir sans plus attendre.
William Fisk: Portrait of George Catlin (1849)
Bison
Patrick Grainville / Editions du Seuil, 2014; Editions Points Seuil poche, 2015
Warm Shadow, de Fink (2011)
“What you got goin’ on
Behind those eyes closed, holdin’ on
I don’t want another day to break
Take our, steal our night away”