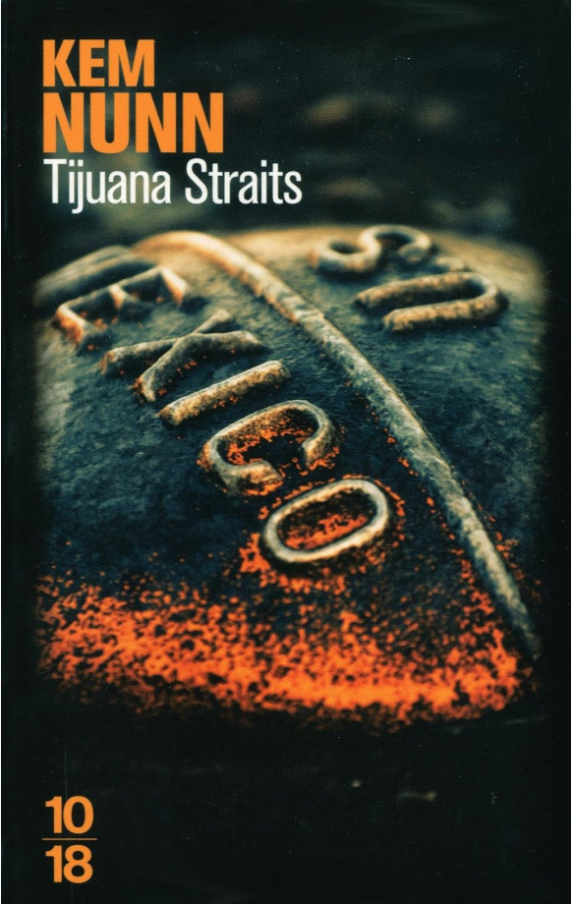Quién es? Quién es?
“On l’aimait pour tout un tas de raisons. Certains parce qu’ils le craignaient, d’autres parce qu’ils l’admiraient, d’autres encore parce qu’ils le haïssaient. Mais je crois que la plupart étaient attirés par son incroyable bonne fortune. On ne pouvait pas s’empêcher de se demander comment c’était possible d’avoir autant de veine. J’ai entendu des gens dire que ce genre de chance, ça n’arrivait qu’une fois tous les cent ans, et que quand ça arrivait, il n’y avait rien qui puisse en infléchir le cours. D’autres disaient qu’il n’y a que les enfants pour être aussi vernis, et c’étaient les mêmes qui plus tard diraient que le Kid n’était plus un gamin. Il n’était qu’un jeune garçon quand on l’a affublé de ce sobriquet, et il était temps qu’il s’en trouve un autre car toutes ces années l’avaient changé, mais il est mort avec ce nom et il l’aurait gardé même s’il avait vécu quatre-vingt ans.”
Le Kid est mort et enterré, son corps repose en paix en quelque lieu tenu secret, faisant face à l’immense baie, au Pacifique grandiose de bleu profond céleste, ultramarin, azur et écume lactée confondus, mélange de l’air et du liquide, sans aucun horizon, sans aucune limite. Sur les terres alentour, sur le rivage et jusqu’aux villes de Monterey, de Salinas, en cette Californie d’or et de rêve où le jeune bandido a balancé les dernières cartes du jeu où il misait sa vie, quelques touristes et voyageurs attirés par l’aura de la légende naissante commencent déjà à tenter d’exhumer les quelques mirages de ses reliques sacrées. Il y a de ces rapaces qui voleraient un doigt au cadavre encore chaud pour l’exposer dans toutes les foires de la région; de ces écrivaillons de l’est prêts à tordre l’histoire, à salir la mémoire, pour vendre leur torchon; et puis de ces opportunistes prétendant revenir de l’enfer, du désert infini, bien sûr jamais tombés, maintenant affublés d’un nom volé et d’une vieille pétoire, vêtus de ce clinquant costume de pistolero bien trop grand pour eux. Les rumeurs vont bon train et s’emballent; seuls ceux qui l’ont connu se taisent, les paisanos qui l’ont hébergé, les amis et complices, fidèles au souvenir de l’enfant du pays. Parmi eux, Doc Baker, le dernier survivant de la bande d’outlaws menée par le Kid, qui l’a accompagné jusqu’aux derniers instants. Doc qui l’a vu mourir et qui a creusé sa tombe. Face à l’injure des mensonges qui se tissent sous ses yeux, il se décide enfin à parler: ce sera à lui, et lui seul, qu’il reviendra de raconter La véritable histoire de la mort d’Hendry Jones.
Lost in l’America: Point Lobos, Californie. Une tombe au pied d’un cyprès
Légende dorée, mordue de rouille et de poussière, du Kid qui n’est pas Billy, qui ne le sera jamais car Billy est un autre, dépouille maudite crevée dans le lointain Nouveau-Mexique; lui-même c’était Hendry quand il était du bon côté, jusqu’à ce que sa bouille d’ange déchu et sa témérité de jeune criminel ne l’aient porté à la tête d’un gang de voleurs de bétail et d’agitateurs publics. Figure du rebelle éternel, ami et protecteur des indianos et des métèques, ou racaille sans scrupules avide d’entailler plus encore la crosse de son colt, dans un pays où la loi n’est définie qu’en fonction d’où pointe le canon, il a pourtant connu le même chemin de croix que celui qui l’a inspiré. L’emprisonnement dans une geôle sordide, le jugement et la sentence de peine de mort, lui digne d’être pendu haut et court pour l’exemple, avant l’évasion spectaculaire dont personne ne croyait. La fuite vers le Mexique, et l’étonnant retour sur les terres où il est recherché, tentant autant de renouer avec un amour perdu qu’il ne s’amuse de la chasse lancée contre lui par le shérif Dad Longworth, ancien ami filou anobli par l’étoile, un Pat Garrett revisité en figure du grand-frère, ou du père impossible. Jusqu’à l’improbable retrouvaille, dans l’étroit confinement d’une chambre baignée de ténèbres; l’appel paniqué du Kid face au vide apparent: Quién es? Quién es? Le silence, qui est le silence? Et rien qu’une salve de balles en réponse. L’histoire est vraie, l’histoire est absolument vraie. Parole d’évangile du dernier apôtre, le briscard Doc Baker, témoin des derniers mois sur terre du céleste gamin.
William Henry McCarty – Billy the Kid…
…William Harrison Bonney, Henry Antrim, William Antrim, Kid Antrim, Hendry “The Kid” Jones… Autant de noms d’emprunt pour tenter de brouiller les pistes. Le livre de Charles Neider n’échappe pas à la règle, et propose même de transporter le mythe jusqu’en Californie, le long d’une côte tourmentée et si pleine de vie, qui inspira aussi Steinbeck, Miller et d’autres écrivains ayant trouvé refuge près de Big Sur, de Point Lobos et de la baie de Monterey. Le paysage devient d’ailleurs un personnage à part entière, amplifiant le débit narratif au rythme des vagues saccadées, sublimant de l’aube au crépuscule la tragique épopée. On pense beaucoup à ce que l’on connait soi-même de la légende de Billy the Kid à la lecture de ce roman, publié aux États-Unis en 1956, et il est intéressant de découvrir que le texte aurait dû être porté à l’écran par Sam Peckinpah, avant que Marlon Brando ne reprenne le flambeau, réalisant ainsi le seul film de sa carrière (One-eyed Jacks, 1961). Quelques années plus tard, Peckinpah tournerait l’un de ses chefs-d’œuvre, Pat Garrett and Billy the Kid (1973). Qu’a-t-il indirectement retenu de La véritable histoire de la mort d’Hendry Jones? Il faudra repenser à prestation du magnifique Kris Kristofferson pour s’en faire une idée, même si l’effort est moindre, tant cela saute aux yeux. C’est en tout cas ce que j’ai bien voulu voir, et j’en ai eu pour mon grade. J’ai vraiment savouré ce livre extraordinaire, avec l’impression de remettre des mots et un sens sur une histoire que je me répétais en bégayant depuis gamin. Peut-être que finalement j’y ai compris quelque chose, sans en avoir fait le tour. Et même, je m’en fiche, j’étais comme dans un rêve de l’un de mes rêves de gosse, et c’est ça qui m’a porté. J’espère que vous-mêmes y trouverez votre compte, vous pouvez y aller tête baissée.
PS: Ai donc découvert les éditions Passage du Nord-Ouest, ainsi que leur collection Short Cuts. Dans la même collection que La véritable histoire de la mort d’Hendry Jones, les romans Josey Wales hors-la-loi, Les Proies, Luke la Main Froide… Qu’est-ce que ça veut dire? Quelle est cette merveille de catalogue que j’ai sous les yeux? À suivre de très près…
“La véritable histoire de la mort d’Hendry Jones” (The authentic death of Hendry Jones – 1956)
Charles Neider / Editions Passage du Nord-Ouest, 2014
Traduit par Marguerite Capelle et Morgane Saysana
Far from any road – The handsome family ( 2003) – Ride that horse…